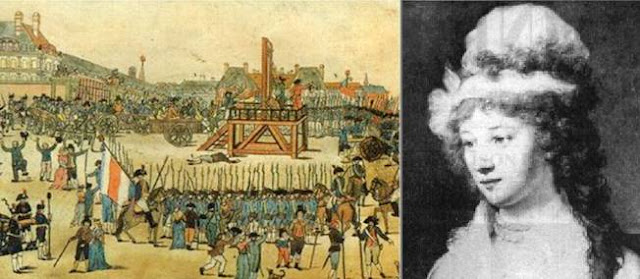Eric Verhaeghe : Si l'on écoute les déclarations de Benoît Hamon, l'économie sociale et solidaire, c'est un idéal romantique, une sorte de paradis perdu pour l'économie. Elle réunit des gens qui s'aiment, qui travaillent entre eux pour le bonheur de l'humanité, et qui ne s'intéressent qu'au progrès de la civilisation dans un esprit totalement démocratique, par opposition à l'horrible monde capitaliste paré de tous les vices.
 |
| Encore un bisounours incompétent |
Cette construction totalement fantasmée est plutôt divertissante, au moment où la Cour des Comptes écorne une fois de plus une structure de l'économie sociale et solidaire proche du Parti Socialiste: la mutuelle des étudiants (LMDE), l'ancienne MNEF. C'est pourtant une maison que Benoît Hamon connaît bien, puisque, sauf erreur de ma part, il en fut salarié pendant 3 mois au début des années 1990.
La LMDE est probablement la première organisation de l'économie sociale et solidaire à laquelle les étudiants sont confrontés en France. Après un rapport parlementaire, après une enquête d'UFC, la Cour des Comptes en confirme une description très différente du portrait idyllique que Benoît Hamon aime dresser à propos de l'ESS (économie sociale et solidaire, ndlr). La LMDE rembourse tardivement les étudiants qu'elle assure - et quand je dis tardivement, c'est un euphémisme - sans considération des difficultés que cela représente pour cette population précaire. La LMDE aime gaver ses amis politiques, mais elle était en début d'année en quasi-faillite. Et sa présidente, ex-présidente de l'UNEF, vient d'avouer qu'elle est incapable de produire les coûts de gestion de sa structure pour les années en cours, alors même qu'un décret vient d'être publié pour contraindre les mutuelles à faire la transparence sur ces coûts.
Il me semble qu'il suffit d'évoquer le cas de la LMDE pour invalider les propos de Benoît Hamon sur un sujet qu'il semble connaître de façon purement livresque. Que l'on soit clair, je trouve très bien qu'il existe une économie sociale et solidaire. C'est un mode de gestion intéressant. Maintenant, l'ériger en modèle d'avenir et lui prêter une supériorité morale sur la gestion capitaliste relève d'un sectarisme idéologique en rupture complète avec la réalité.
Apologie de la gestion « désintéressée », de la gouvernance démocratique ou du fait de ne pas faire de la recherche des bénéfices l'objectif principal d'une entreprise : une telle approche traduit-elle la méconnaissance, ou le mépris, profond du gouvernement pour les principes fondamentaux de l'économie ? Est-il aveuglé par l'idéologie ?
Eric Fromant : L’idéologie n’est sans doute pas loin, voire tout près, mais l’idée selon laquelle il faut continuer d’abaisser les coûts au point de réduire les salaires est suicidaire.Henry Ford disait : « J’augmente mes salariés parce qu’ils vont acheter mes voitures et j’abaisserai les coûts par le volume. ». Aujourd’hui, l’idéologie de l’abaissement des coûts fait l’inverse.
Eric Verhaeghe : Je dirais surtout que le gouvernement est aveuglé par les effets de manche de l'économie sociale et solidaire, qui agite souvent le hochet de valeurs nobles et positives pour cacher des vérités un peu plus sordides. Je crois par exemple que le plus gros acteur de l'économie sociale et solidaire en France s'appelle le Crédit Agricole. Je veux bien prendre au hasard n'importe quel client du Crédit Agricole en France et lui demander si la gouvernance de sa banque est démocratique, peu lucrative, peu tournée vers le profit, et respectueuse des grandes valeurs de solidarité que l'on nous met sous le nez quand le gouvernement parle de ce sujet. Je parie que ce client pris au hasard me rira au nez dans le meilleur des cas.
Je ne veux pas dire que le Crédit Agricole est une banque pire que les autres. Je veux juste dire que l'appartenance du Crédit Agricole à l'Economie Sociale et Solidaire ne me semble pas en faire une banque supérieure aux autres.
Maintenant, si l'on aborde les sujets qui fâchent, il faut parler des salaires. Globalement,travailler dans l'économie sociale et solidaire, c'est sans doute aimer son prochain, mais c'est surtout consentir à des salaires plus bas que dans le secteur capitaliste. Car le gouvernement oublie régulièrement de préciser ce point : à métier ou activité équivalente, les entreprises capitalistes paient nettement mieux leurs salariés que les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et je ne parle pas seulement du secteur associatif qui est généralement invoqué pour expliquer cette différence. Je parle bien d'entreprises sociales et solidaires qui sont en concurrence directe avec des entreprises capitalistes : elles offrent généralement des salaires très inférieurs à leurs collaborateurs, et se montrent très pingres dans leurs augmentations salariales.
Ce point me paraît devoir être souligné ! Car derrière les postulats idéologiques que l'on nous sert en sauce comme du beurre en branche, il y a les faits. Et les faits, c'est que les employeurs de l'économie sociale et solidaire ne sont pas spécialement tendres avec leurs salariés. Il y au moins autant de faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, d'injustice dans les rémunérations et de stress ou de souffrance au travail dans l'économie sociale et solidaire que dans le secteur capitaliste.
Selon des études mises en avant par le ministère, dont celui de Francis Vercamer, le député UDI du Nord publié en 2010, l'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui 10% du PIB de la France et 10% des emplois, soit 2,35 millions de salariés. Selon le ministre, les mesures du projet de loi sont susceptibles de créer plus de 100.000 emplois nets par an. Qu’en est-il réellement ? Quel est le potentiel réel de ce secteur vis-à-vis des autres ? Sa place dans l'économie est-elle amenée à se développer fortement ?
Eric Verhaeghe : D'abord, je ne vois pas en quoi 100.000 emplois nets par an est un chiffre ambitieux, si ces emplois sont précaires ou mal payés, ce qui est quand même souvent le cas dans le secteur associatif. Car le chiffre, là encore, dissimule une réalité dont on parle peu : les 100.000 emplois en question s'ils existent, sont d'abord des emplois dans des associations, ordinairement dans le secteur de l'aide à la personne. Personnellement, je trouve cela très bien, mais je ne suis sûr que tous les Français rêvent pour leurs enfants d'un avenir de ce type. Et je pense que M. Vercamer lui-même n'en rêve pas pour ses enfants.
Maintenant, il y a quand même un problème structurel dans l'économie sociale et solidaire, qui est probablement le vrai sujet de notre époque : celui de l'accès au capital. Parce que les entreprises de l'ESS n'ont pas d'actionnaires, elles ont un faible accès au capital, par définition, et ont donc des possibilités d'investissement très limitées. Cette limite est un handicap majeur dans un monde capitaliste.
Le gouvernement l'a bien vu, puisqu'il crée, à la demande des acteurs du secteur, des certificats mutualistes, qui sont une sorte de Canada Dry du capitalisme. Les certificats mutualistes, ce sont des actions pour économie sociale et solidaire, rémunérées comme des actions dans le secteur capitaliste. Même si la loi pose quelques garde-fous totalement illusoires, la loi Hamon est en réalité en train de transformer l'économie sociale et solidaire en secteur capitaliste qui ne dit pas son nom. C'est la seule façon de permettre son développement.
Eric Fromant : Tout dépend de l’objectif. On ne peut exclure un effet d’annonce, réflexe de nos gouvernants depuis longtemps. Si l’ESS vise à développer des emplois peu qualifiés et donc peu payés, mais aussi à faible valeur ajoutée, cela est possible. Mais la vraie sortie de crise est évidemment ailleurs. Les emplois à basse qualification n’ont jamais initié un enrichissement général.
Comme suite à ma réponse précédente, il faut lutter contre une idée préconçue et malheureusement répandue consistant à ne parler que du coût de la main-d’œuvre. Celui-ci n’a aucun sens par lui-même. C’est le rapport de ce qu’elle rapporte sur ce qu’elle coûte qui en a un. C’est ce qui explique que, dans les années 60-80, l’Allemagne avait la main-d’œuvre la plus chère mais que son économie tournait à plein régime. L’ESS est partie d’une bonne idée, mais plus elle se développera, moins l’économie sera restructurée pour être à la fois compétitive et créatrice d’emplois de haut niveau.
Le projet de loi sort le grand jeu pour favoriser le développement des Scop, sociétés coopératives et participatives. Pour faciliter les reprises de petites entreprises par leurs salariés, le texte prévoit par exemple que ceux-ci soient informés au moins deux mois à l'avance d'un projet de cession. Le patronat dénonce les effets pervers de cette disposition. Quels sont-ils ? Le gouvernement n'a-t-il pas par ailleurs tendance à idéologiser le modèle coopératif ?
Eric Verhaeghe : Les rédacteurs de la loi n'ont évidemment jamais cédé une PME. Les questions que ce type d'opération pose leur sont donc passées totalement à côté de l'esprit. Pourtant, elles sont simples à comprendre. Par exemple, si vous voulez faire construire une maison de maçons, et que vous allez trouver une entreprise de maçonnerie, vous vérifiez une première chose : sera-t-elle encore en activité lorsque je lancerai le chantier ? La solidité de l'entreprise est un critère essentiel de choix. Si l'entrepreneur vous dit qu'il vient d'annoncer la cession de l'entreprise dans les deux mois à ses salariés, il est évident que vous ne chercherez pas à faire affaire avec lui. Vous serez prudent et vous attendrez. Si, au bout de deux mois, les salariés ont décidé de ne pas reprendre, vous vous demanderez pourquoi. Entre-temps, les clients seront partis parce qu'ils auront fait comme vous, et la valeur de l'entreprise aura diminué, puisque son chiffre aura baissé. Le propriétaire de l'entreprise fera donc une moins bonne transaction.
L’État est le premier à se comporter de cette façon. Pour décrocher un marché public, il faut démontrer sa capacité à durer. Ce réflexe peut se comprendre : on ne contracte pas avec quelqu'un qui part. C'est pourquoi les cessions de PME ou de TPE se font dans le plus grand secret.
L’investissement politique en matière d’économie sociale et solidaire est-il disproportionné au regard de ce qui a été fait pour les autres entreprises ?
Eric Fromant : Ce type d’investissement peut avoir un sens si l’on est orienté court-terme, mais cela ne permettra ni de sortir de la crise, ni de construire une économie aux bases solides, c'est-à-dire génératrice de valeur ajoutée et d’emplois pour plusieurs décennies. Les fleurons encore actuels de l’économie française, crées sous de Gaulle et Pompidou, Ariane, le TGV, Airbus, les centrales nucléaires ont été fondés avec d’autres ambitions.
Eric Verhaeghe : Je présenterais les choses autrement. Si le gouvernement créait un poste de ministre du Capitalisme, il serait d'emblée suspect (à raison) d'être le porte-parole des capitalistes. Benoît Hamon, assez naturellement, est le porte-parole de l'économie sociale et solidaire. C'est une sorte de lobbyiste en chef. Je le redis, je trouve très bien qu'il existe un secteur de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, il ne faut pas prendre les gens pour plus idiots qu'ils ne le sont, et chercher à faire prendre ce secteur pour une sorte de promesse de bonheur ne correspond à aucune réalité.
Quelles sont les vraies priorités en matière d'entrepreneuriat auxquelles le gouvernement devrait s’attaquer d’urgence ?
Eric Verhaeghe : Je suis partisan d'une démarche "en biais". Je préconise de réunir un groupe de 5 ou 6 inspecteurs URSSAF et inspecteurs du travail, et de leur demander d'inspecter Google, au siège de Google aux Etats-Unis. J'imagine que tous ces gens rodés à l'application de nos innombrables textes législatifs et réglementaires vont ressortir de cette mission avec une quantité phénoménale de remarques, de PV, d'injonctions. On prend toute leur littérature, et on a la réponse à la question que vous posez : vous saurez ce jour-là tout ce qu'il faut supprimer dans le Code du Travail et dans le Code de la Sécurité Sociale pour redonner à la France le rôle qui lui revient dans le monde.
Eric Fromant : Il est urgent de rétablir l’entrepreneuriat, aujourd’hui mis en grande difficulté parce que les exigences financières à court terme l’interdisent. Le temps de l’économie réelle n’est pas celui de la finance. C’est l’industrie seule qui crée la richesse ; la part des services doit croître mais seuls les services liés à l’industrie sont à haute valeur ajoutée (Cf. ‘’La France sans ses usines’’ de Patrick Artus), donc générant de hauts salaires.
Il est urgent de lutter contre le « business as usual » qui privilégie la duplication d’un modèle fatigué, voire obsolète pour favoriser les résultats à très court terme et qui interdit en pratique de vraies innovations.
Il est urgent d’adapter l’économie française aux réalités de la nouvelle époque qui se met en place sous nos yeux : pénurie et hausse des prix des ressources matérielles, 2ème phase de la mondialisation qui voit les échanges entre continents se réduire et les échanges intracontinentaux ou sous-continentaux exploser (voir le rapport Euler-Hermes à ce sujet), abandon de la notion de chiffres d’affaires pour privilégier la valeur ajoutée, évolution du consommateur qui divorce d’avec les grandes marques parce qu’elles ont divorcé d’avec la société, retour des entreprises dans une problématique d’intégration dans les territoires.
De nombreuses entreprises ont pris contact avec l’Institut de l’économie circulaire parce qu’elles ont besoin d’une adaptation aux nouvelles réalités, parce qu’elles ont besoin de nouveaux business models "rupturistes". Ce n’est pas un hasard. Dans son excellent livre, « Les 7 piliers de la croissance », Pierre Gattaz ne dit pas autre chose. Il n’est sans doute pas un hasard qu’il ait été élu président du Medef. Il a semblé être l’homme de la situation, de la nouvelle époque.
Au 19ème siècle, on a fermé les fabriques de diligences et on a ouvert des usines de trains et d’automobiles. Si l’on continue de faire de la gestion à court terme, on fermera les fabriques de diligences, pardon d’automobiles, sans ouvrir les usines des produits du 21ème siècle !