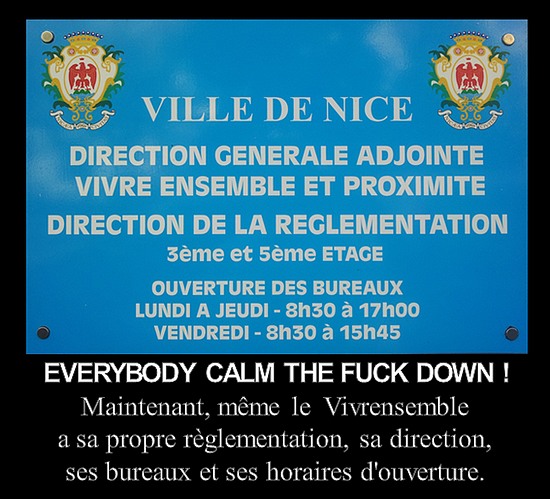Dans cet essai de 1956, Mises entend démonter un à un les arguments des anticapitalistes et analyser les ressorts de la pensée anticapitaliste.
Ludwig von Mises, La Mentalité anticapitaliste, 1956. Édité par l’Institut Coppet, préface de Benoît Malbranque.
Ludwig von Mises, dans ce bref essai, rédigé en pleine guerre froide et alors que les partis communistes et travaillistes étaient au plus haut partout, constate un paradoxe évident : alors que les pays occidentaux prospèrent de plus en plus grâce au capitalisme, de nombreuses personnes, notamment des intellectuels, le haïssent ; de telle sorte que le mot même de « capitaliste » est une insulte dans la plupart des pays. Mises entend donc démonter un à un les arguments des anticapitalistes, et même analyser les ressorts de la pensée anticapitaliste. Son propos est cinglant, sans concession, et l’œuvre de vulgarisation à laquelle il se livre est d’une grande efficacité.
En premier lieu, Mises donne l’une des définitions les plus efficaces et limpides du capitalisme. Six idées simples permettent de le caractériser :
- L’œuvre fondamentale du capitalisme, c’est la « déprolétarisation » de l’homme ordinaire, qui est progressivement sorti de la misère pour devenir bourgeois.
- Cette déprolétarisation est universelle : il s’agit d’une ascension de la multitude. Et elle est irréversible.
- Elle est basée sur l’avènement du consommateur souverain ; par une sorte de plébiscite de tous les jours, pour paraphraser Renan, le consommateur détermine qui sera riche et qui ne le sera pas ; le consommateur donne sa confiance, mais peut aussi la retirer immédiatement
- Il est bien clair que l’accumulation des biens matériels ne rend pas en tant que telle les individus heureux ; dès que nos désirs sont satisfaits, d’autres apparaissent. La nature humaine est ainsi faite. Mais c’est précisément ce penchant même qui est vertueux : cet appétit, ce désir constant d’améliorer son sort, engendre l’amélioration économique.
- Si l’humanité a accru son bien-être, c’est parce que l’accumulation du capital a été supérieure à la croissance de la population.
- Enfin, il ressort de tout cela que le capitalisme est l’exact contraire de la société de statut. Alors que la richesse d’un aristocrate n’est pas issue du marché, ne peut être remise en cause par le peuple, et que la place de ce dernier est fixée à tout jamais, la richesse du capitaliste, elle, est due au peuple, et elle s’évapore instantanément si un autre individu lui apporte mieux ou moins cher ; n’importe qui peut défier à tout moment n’importe quel millionnaire.
La diabolisation du capitalisme trouve son fondement dans la frustration. Or, celle-ci est décuplée dans un régime capitaliste. En effet, alors que dans une société de caste, l’individu en bas de l’échelle n’y peut rien, car sa position n’est pas due à ce qu’il fait mais à ce qu’il est, et plus encore à là où il est né, dans une société capitaliste au contraire, sa situation ne dépend que de lui. Le capitalisme traite chacun selon sa contribution au bien-être de ses semblables. Et on trouvera toujours quelqu’un qui a mieux réussi que soi, ce qui est difficile à admettre. Par facilité, on peut avoir envie de trouver des boucs émissaires qui masquent cette réalité. Or en régime capitaliste, l’inégalité est visible (qu’il s’agisse de capacités physiques ou intellectuelles, de volonté, de réalisations…), et il faut apprendre à vivre avec.
Quatre acteurs au moins, selon Mises, refusent d’admettre cette frustration :
- les intellectuels d’abord, qui exècrent les riches.
- les cadres, qui ne comprennent pas qu’ils ne soient pas toujours mieux payés que les ouvriers. Ils refusent de voir que bien souvent leur travail est routinier et sans valeur ajoutée, du moins sans plus de valeur ajoutée qu’un travailleur manuel.
- la jeunesse dorée des beaux quartiers, qui, venant de milieux aisés, méprise l’argent. C’est pourtant cet argent, gagné par leurs parents, qui les entretient et leur permet d’être des socialistes de salon.
- les artistes, par exemple ceux de Broadway et d’Hollywood, qui refusent d’admettre d’une part que produire et se produire dans un spectacle n’est pas d’une nature économique différente de produire des brosses à dents, et d’autre part qu’ils peuvent très bien être au zénith un jour et plus rien le lendemain ; ils s’accrochent au communisme pour se prémunir contre ce risque.
Mises tord ensuite le cou à trois sophismes. En premier lieu, dit-il, on considère que l’amélioration matérielle est le fruit du « progrès technique ». Or ce concept flou n’explique rien. Comme s’il y avait une sorte de mantra, une pensée magique, qui attribuerait de manière automatique l’amélioration du bien-être matériel à la technologie. Comme le rappelle Mises, au contraire, aucune amélioration technique ne peut exister si le capital nécessaire n’a pas été préalablement accumulé par l’épargne. Et c’est la propriété privée de moyens de production qui permet cette accumulation.
Ensuite, ce même progrès ne provient pas non plus de l’amélioration de la « productivité » du travail. C’est confondre la cause et les conséquences d’un phénomène. Ce sont, au contraire, les épargnants et les entrepreneurs qui, en accumulant du capital productif, et en en accumulant plus que l’accroissement de la population, sont à l’origine réelle de l’accroissement de la productivité marginale du travail et de la baisse continue du prix des produits que nous achetons.
Enfin, Mises rappelle que personne n’est pauvre parce que d’autres sont riches. Les richesses du riche ne sont la cause de la pauvreté de personne. La richesse de certains ne vient que de leur capacité à satisfaire, et à mieux satisfaire que les autres, les besoins des individus.
La littérature est un vecteur majeur de la pensée anticapitaliste. Si, dans une société capitaliste, l’individu est libre, sa liberté de création n’entraîne pas nécessairement richesse. Pour qui veut s’enrichir par son écriture, il faut tenir compte de l’appréciation des consommateurs. Mais est-ce vraiment spécifique au capitalisme, ou même pire qu’auparavant ?
Pendant les temps précapitalistes, écrire est certes un art, mais qui ne rapporte rien. C’est précisément la création, progressive, au Moyen Âge, d’un marché des produits littéraires qui constitue une composante essentielle d’émancipation face à la royauté. De tout temps, la littérature est synonyme de dissidence.
Mises convient néanmoins tout à fait que les auteurs les plus prospères, nos Marc Lévy et Guillaume Musso d’hier comme d’aujourd’hui, sont ceux qui écrivent pour les masses, et pas nécessairement de la meilleure qualité. En effet, si le capitalisme a rendu les gens suffisamment prospères pour acheter des livres, il ne leur a pas donné le discernement pour autant.
Mises rappelle aussi que la liberté de la presse ne saurait exister que dans un régime capitaliste ; il est bien clair en effet que si l’État détient tous les pouvoirs, aucune critique n’est possible contre les syndicats, les partis, le gouvernement, l’État-providence… Or la critique, c’est l’essence même de la presse. Il évoque aussi le cas des « romans sociaux », de Zola à Olivier Adam, dans lesquels le mal est bourgeois et le bien prolétaire. Il est évidemment légitime de dépeindre la misère, et les plus grands (Dickens, Steinbeck, Hugo…) s’y sont livrés. Mais il convient de ne pas tomber dans de fausses interprétations : la misère, bien évidemment choquante, vient de l’absence de capitalisme, des vestiges précapitalistes, des politiques sabotant le capitalisme, pas du capitalisme lui-même. Il ne faut jamais oublier qu’un prolétaire, quel qu’il soit, c’est aussi un consommateur (de biens, de nourritures, de matières premières), et par conséquent le maître acteur, pour ne pas dire le metteur en scène, du capitalisme.
Mises conclut son opuscule en répondant à cinq objections non économiques au capitalisme.
On dit que l’argent ne fait pas le bonheur. C’est vrai. Mais si les gens travaillent, épargnent, investissent, consomment, c’est pour éliminer un malaise ressenti, et donc être plus heureux qu’auparavant. On ne saurait le nier.
Ensuite, on rabaisse souvent le capitalisme au seul matérialisme, et les intellectuels, en particulier, se disent, eux, au-dessus de ces basses considérations. Après avoir rappelé que cette posture est ambiguë, qu’elle idéalise les artistes du passé à la hauteur de l’ignorance des contemporains, Mises ajoute que le matérialisme n’est en rien l’apanage des temps capitalistes ; aucun riche, même très riche, capitaliste, ne l’est autant que les rois et les princes qui ont fait construire Versailles ou l’Escurial.
Le capitalisme n’est pas injuste ; on peut passer sa vie à rêver d’un monde imaginaire. Mieux vaut regarder le monde tel qu’il est. Et lorsqu’on se livre à cet exercice, on observe :
- que la nature n’offre pas tout, elle n’est pas généreuse mais avare. La survie et le bien-être sont la conséquence du talent et de l’effort par lequel l’homme use de sa raison, sa seule arme.
- les pays pauvres le sont non pas parce que les riches les exploiteraient, mais parce que leurs politiques d’expropriation, de taxation discriminatoire, de contrôle des changes, ont à la fois écarté les investissements de capitaux étrangers, et empêché l’accumulation des capitaux nationaux.
- l’épargne est indispensable, non seulement parce qu’elle permet d’investir, mais aussi parce que les biens en capital sont toujours des biens intermédiaires et périssables. Tôt ou tard en effet, ils seront totalement usés par le processus de production. Il faut donc nécessairement consacrer une part de l’effort productif au renouvellement des biens du capital.
- le capital n’est donc pas un don gratuit qui tombe du ciel. Il vient de la réduction prévoyante par les individus de leur consommation, donc de leur épargne, et de leur abstention de consommer celle-ci pour renouveler le capital et le développer.
- le capitalisme est d’autant moins injuste qu’il engendre une hausse tendancielle des salaires. Laquelle ne dépend pas du tout de la productivité individuelle de chaque travailleur, indiscernable, mais de la productivité marginale du travail, autrement dit du fait que l’accumulation du capital est supérieure au taux d’accroissement de la population.
Enfin, Mises insiste sur le fait qu’adopter une constitution, rédiger une « déclaration des droits », ne suffisent pas à instaurer un régime de liberté. Il faut en plus une économie de marché, une économie capitaliste. Seule l’économie de marché nous rend libres de la manière dont on veut servir nos semblables ; seule l’économie de marché nous permet de contester les intérêts de n’importe qui ; seule l’économie de marché nous rend libre de changer de travail si on le souhaite.
Chacun de nous, parce que nous sommes tous acheteurs et consommateurs, faisons partie de la Cour suprême qui attribue à tous (et donc y compris nous-mêmes) une place donnée dans la société. La liberté en régime capitaliste, c’est donc ne pas dépendre davantage de l’arbitraire des autres que les autres ne dépendent du nôtre. L’Orient, qui a pourtant produit dans le passé tant de savants, de philosophes, d’œuvres fabuleuses, est resté depuis bien longtemps maintenant à l’écart du progrès mondial. Pourquoi ? Parce qu’il lui manque, de l’Asie au Proche-Orient, cette idée fondamentale qui est au cœur du capitalisme : l’idée de liberté de l’individu face à l’État.