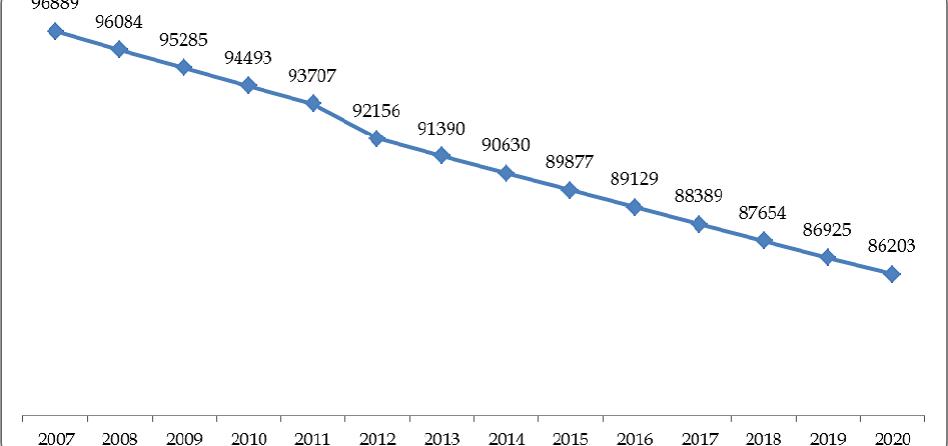jeudi 10 juillet 2014
Huile d’olive : la justice européenne confirme une amende de 250 millions pour la Grèce
La justice européenne a confirmé jeudi une amende de 250 millions d’euros infligée à la Grèce pour non-respect des règles en matières d’aide à l’huile d’olive.
La Cour de justice de l’UE a rappelé que la Grèce n’avait «pas achevé le système d’information géographique oléicole et le système d’identification des parcelles agricoles», qu’elle doit mettre en place dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC).
En 2007, des inspecteurs de la Commission ont effectué en Grèce deux enquêtes qui ont révélé des carences dans les contrôles opérés par les autorités nationales en matière d’aides à l’huile d’olive et aux cultures arables.
En avril 2011, la Commission a appliqué aux dépenses déclarées par la Grèce des corrections d’un montant de plus de 250 millions d’euros.
La Grèce a contesté cette décision devant le tribunal de l’UE, qui l’a validée en confirmant que le système de contrôle de la Grèce accusait des «défaillances répétées» et que ce pays «se trouvait en situation de récidive».
Le tribunal a estimé que la Commission n’avait «pas violé le principe de proportionnalité», dans le calcul de la sanction financière.
La Cour de justice de l’UE, saisie en appel, a tranché jeudi que les juges de première instance avaient «correctement conclu que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’évaluation du caractère récurrent des défaillances».
La Grèce «n’a pas démontré que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité», ajoutent les juges.
L'EUROPE COMMENCE A SÉRIEUSEMENT NOUS EMMERDER
Mort de la médecine libérale
Marisol Touraine veut être celle qui marquera l’histoire de la santé. Elle y est presque : le but quasi avoué est de faire disparaître la médecine libérale.
 Si l’on veut faire des médecins généralistes des fonctionnaires, il faudra le leur dire dès le début de leurs études, et leur accorder alors tous les avantages de cette catégorie : certes ils ne choisiront plus leur lieu d’exercice ou le contenu de leurs prescriptions. Mais il faut que les patients se rendent compte qu’eux non plus ne seront plus libres de choisir leur médecin ni de lui demander des petits ajouts sur l’ordonnance. Le médecin ne sera plus libre de prescrire ce qui lui semble le plus adéquat pour son patient. Mais cette consultation au rabais sera gratuite. Tout dépendra désormais de la CPAM qui sera le payeur, donc le décideur.
Si l’on veut faire des médecins généralistes des fonctionnaires, il faudra le leur dire dès le début de leurs études, et leur accorder alors tous les avantages de cette catégorie : certes ils ne choisiront plus leur lieu d’exercice ou le contenu de leurs prescriptions. Mais il faut que les patients se rendent compte qu’eux non plus ne seront plus libres de choisir leur médecin ni de lui demander des petits ajouts sur l’ordonnance. Le médecin ne sera plus libre de prescrire ce qui lui semble le plus adéquat pour son patient. Mais cette consultation au rabais sera gratuite. Tout dépendra désormais de la CPAM qui sera le payeur, donc le décideur.
Résumé : la sécurité sociale a « un trou » que personne n’arrive à combler. Les dépenses continuent à filer. Il faut faire quelque chose.
Et si on jetait le discrédit sur une partie de la population qui ne dit jamais rien, et sur laquelle il sera facile de s’acharner ? Les médecins libéraux.
Ces nantis, qui ont le mauvais goût d’être plus nombreux au soleil ou près des villes que dans le nord ou en rase campagne.
 |
| Folle a lier !!!! |
Ces nantis, dont les études sont « payées par l’État ». C’est loin d’être les seuls (on pense par exemple à tous les titulaires d’un CAP ou d’un Bac Pro), mais les autres professions ont la chance de ne pas être liés à l’État par la suite. On ne rembourse pas encore le croissant du matin ou la fuite d’eau inopinée un samedi après-midi.
Ces nantis qui se payent grassement sur le budget de la sécurité sociale, puisque c’est la CPAM qui rembourse toute consultation.
Pourquoi ne pas leur octroyer un salaire payé directement par la CPAM ? Ainsi, on pourrait :
- Les fonctionnariser, donc les contrôler ;
- Ne pas les payer s’ils ne font pas ce que la CPAM a décidé (par exemple ne pas les payer s’ils écrivent sur l’ordonnance « non-substituable » ou si la prescription est considérée comme trop onéreuse par la Sécurité Sociale) ;
- Les obliger à faire de nouvelles tâches administratives, donc décharger la Sécurité Sociale, tellement submergée déjà, en faisant faire au médecin ce qui est normalement du ressort de la CPAM (vérifier la validité des droits des assurés par exemple).
Il est prévu de déléguer cette tâche au médecin lui-même, qui devra vérifier tout seul que le patient assis en face de lui est bien à jour de ses droits (je vous laisse imaginer le surréaliste dialogue du médecin disant à son patient qu’il n’est pas à jour de ses droits et donc monsieur/madame je ne vais pas pouvoir vous examiner sinon je ne serais pas payé). Le travail administratif a même été chiffré par les organismes concernés, et il occuperait presque un temps-plein de secrétaire médicale.
Le médecin devra donc vérifier que le patient est à jour de ses droits. Et à la fin du mois, il devra vérifier, patient par patient, dossier par dossier, que la CPAM a bien payé la part du patient, et que la mutuelle a elle aussi bien payé sa part. Il y a environ 600 organismes de complémentaires, pour donner une idée de l’ampleur de la tâche.
Évidemment, aucun système n’étant parfait, il arrivera fatalement que quelques erreurs se glissent dans le paiement. Mais nul n’est parfait. Et puis, un médecin, ça gagne suffisamment pour ne pas venir se plaindre, d’ailleurs avec le chômage et la crise, il serait mal venu de pleurnicher qu’on a trop de travail, et puis il y a la vocation, la fameuse vocation, qui fait que l’on peut bien travailler sans être payé, après tout, c’est pour la beauté du geste.
Ce qui peut arriver (et encore, en ne mettant pas les choses au pire) : à force de tirer sur la corde (sensible) des médecins libéraux, ils vont finir par s’installer de moins en moins en libéral. Il restera essentiellement une médecine publique, à qui l’on n’a pas coupé les vivres, puisque chacun sait bien qu’il n’y a jamais de gaspillage dans le public. Avec la baisse du nombre de médecins, l’hôpital public engagera probablement de plus en plus de médecins étrangers, mal payés (donc économiquement intéressants). Ceux qui voudront continuer à travailler « pour la beauté du geste » seront dans les maisons médicales financées par l’État, ou à l’hôpital. Les autres se déconventionneront (c’est-à-dire mettront fin à tout contact avec la sécurité sociale) et recevront des patients qui peuvent se payer une consultation sans remboursement. Il y aura donc une médecine pour les riches et une pour les pauvres. Les autres médecins ? Certains parlent déjà de « dévisser leur plaque », faire autre chose. Partir exercer à l’étranger.
Alors bien sûr, on dira d’eux qu’ils ne s’intéressent qu’à l’argent. Qu’ils fuient la France pour ne pas payer d’impôts. Évidemment.
Le prétexte des économies est facile, le discrédit d’une profession est inadmissible. Quand le coût de la réanimation est de 1500 à 2000 euros par jour, quand la consultation aux urgences (« gratuite » comme on le sait) représente un coût de 223 euros en moyenne (et non les fameux 23 euros que ne paye même pas le patient), il est ridicule d’imposer la consommation de médicaments génériques dont le prix est bien souvent le même que le prix du médicament princeps ; d’arrêter de rembourser les médicaments prescrits avec la mention « non-substituable ». Ou de donner en pâture aux médias ou à la population le niveau de vie d’un médecin.
L’Université Paris-Descartes et la Chaire santé de Science Po ont, lors des Rencontres du droit et de l’économie de la Santé le 4 Juillet dernier, fait remarquer que les médecins avaient tendance à s’installer « dans les régions où le revenu sera le plus élevé et également dans celles où le nombre d’heures d’ensoleillement est important ». Il serait donc souhaitable d’après les universitaires, d’avoir des incitations financières très élevées pour convaincre les médecins de s’installer ailleurs. Il est surtout prévu des mesures contraignantes pour moduler encore plus fortement le numerus clausus et peser fortement sur la liberté d’installation.
Quel travailleur peut aujourd’hui continuer à payer ses impôts avec contentement sans trouver rien à redire à l’usage qui est fait de cet argent, aux lois qui sont faites au détriment du plus grand nombre ? Quel travailleur accepterait de dispenser son savoir-faire ou son savoir en acceptant d’emblée qu’une partie de ce travail ne soit pas rémunérée ? De se laisser imposer le lieu où il exercera son métier ?
 Si l’on veut faire des médecins généralistes des fonctionnaires, il faudra le leur dire dès le début de leurs études, et leur accorder alors tous les avantages de cette catégorie : certes ils ne choisiront plus leur lieu d’exercice ou le contenu de leurs prescriptions. Mais il faut que les patients se rendent compte qu’eux non plus ne seront plus libres de choisir leur médecin ni de lui demander des petits ajouts sur l’ordonnance. Le médecin ne sera plus libre de prescrire ce qui lui semble le plus adéquat pour son patient. Mais cette consultation au rabais sera gratuite. Tout dépendra désormais de la CPAM qui sera le payeur, donc le décideur.
Si l’on veut faire des médecins généralistes des fonctionnaires, il faudra le leur dire dès le début de leurs études, et leur accorder alors tous les avantages de cette catégorie : certes ils ne choisiront plus leur lieu d’exercice ou le contenu de leurs prescriptions. Mais il faut que les patients se rendent compte qu’eux non plus ne seront plus libres de choisir leur médecin ni de lui demander des petits ajouts sur l’ordonnance. Le médecin ne sera plus libre de prescrire ce qui lui semble le plus adéquat pour son patient. Mais cette consultation au rabais sera gratuite. Tout dépendra désormais de la CPAM qui sera le payeur, donc le décideur.
La gratuité n’existe pas sauf dans les esprits dérangés et formatés par leurs études, faites dans un milieu fonctionnaire par des fonctionnaires pour des fonctionnaires. La gratuité, c’est l’argent que chacun d’entre nous doit donner après ponction sur le fruit de son travail pour que l’État en fasse ce que bon lui semble, et le distribue pour faire « du gratuit ».
Il devient très malsain de laisser penser qu’une catégorie professionnelle, dont la pénibilité au travail ne sera jamais évaluée (la fameuse vocation, les fameux nantis) doit faire encore plus d’efforts, tout cela parce que le budget de la Sécurité Sociale a été géré extrêmement mal par des incompétents qui voudraient en faire retomber la faute sur autrui.
« Il y aura un avant et un après cette loi, qui transformera le quotidien de millions de citoyens » a dit Marisol Touraine. Il est à craindre qu’elle ait malheureusement raison.
Un gouvernement d'apprentis
Le Premier ministre annonce l'instauration d'une prime à l'apprentissage... que le pouvoir venait de supprimer. C'est peut-être le gouvernement qui aurait besoin d'une formation express sur le terrain.
Dans son discours de clôture de la conférence sociale, qui s'est tenue les 7 et 8 juillet au palais d'Iéna, Manuel Valls a annoncé une série de mesures en faveur de l'apprentissage. La plus spectaculaire ? Une "aide de 1 000 euros par apprenti, dans les secteurs professionnels qui ont signé un accord". C'est une bonne idée, alors que le nombre de nouveaux contrats d'apprentissage a baissé de 8 % en 2013, puis encore de 14 % durant les quatre premiers mois de 2014.
Mais pourquoi, dans ce cas, avoir supprimé cette indemnité dans le projet de loi de finances pour 2014 ? Certes, Manuel Valls n'était pas encore à Matignon, mais il appartenait déjà au gouvernement qui a pris cette mesure. La conférence sociale sert donc à restaurer une disposition qui venait tout juste d'être supprimée. Avant la fin 2013, une prime de 1 000 euros par an était versée à toute entreprise qui embauchait un apprenti. Depuis le 1er janvier 2014, elle est réservée à celles de moins de onze salariés. D'après Manuel Valls, il faut donc revenir au plus vite à la situation antérieure. Il n'y a, dit-on, que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !
Un pas en avant, un pas en arrière : c'est le même pas de danse qui rythme la mise en place de la loi sur la pénibilité. Une avancée sociale proposée par la CFDT qui a vite paru ingérable : comment évaluer chaque mois pour chaque salarié dix critères qui vont de la chaleur à l'importance des poids soulevés ? Le gouvernement a dû reculer, et reporter une grande partie du dispositif d'au moins un an.
Des baisses d'impôts ! Avec quel argent ?
Des centaines de millions d'euros consacrés à l'emploi des jeunes - notamment à l'apprentissage -, des baisses d'impôts pour la classe moyenne : ce sont les cadeaux que le Premier ministre a sortis de sa hotte pour faire oublier l'échec de la conférence sociale et illustrer sa volonté de réformer. Excellent ! Mais avec quel argent ? La Cour des comptes soulignait récemment que, sur les 50 milliards d'économies prévus pour les trois années à venir, 30, soit plus de la moitié, dont 13 pour le seul budget de l'État, ne correspondent à aucune réduction précise de dépenses. Annoncer des baisses d'impôts dans une telle situation, c'est audacieux. C'est même suspect, si l'on ne dit rien sur la manière de les financer.
Il semble difficile, en effet, de dégager des marges de manoeuvre en l'absence de réforme de l'État. Mais celle-ci patine depuis plus de deux ans. Comme si la période d'apprentissage de Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, n'était toujours pas terminée. Pour faire avancer les dossiers, Manuel Valls a nommé auprès de lui Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de... la Réforme de l'État. Marylise Lebranchu, elle, est toujours là ! Une étrange manière, pour le gouvernement, de s'appliquer à soi-même les règles de simplification et d'économie...
Dans un discours prononcé à Valence en mars 2012, le candidat Hollande avait déclaré : "Un quinquennat n'est pas un stage d'apprentissage." En effet, l'apprentissage permet de progresser tous les jours
Les aberrations du discours économique
Ceux qui proposent des solutions économiques faciles et des boucs émissaires ont de beaux jours devant eux.
L’économie se veut une science. Elle se pique d’utiliser des outils mathématiques complexes, d’utiliser des méthodologies basées sur l’observation de la réalité, déterminant des lois comme la physique. Elle se gausse aujourd’hui des anciens économistes, qui n’utilisaient pas les mathématiques, et n’y fait pas référence, ne les connaissant pas. Sûrs d’eux, les économistes écrivent des articles péremptoires, devenant même des vedettes, comme le si célèbre Paul Krugman.
Pourtant, le discours des économistes est tellement en contradiction avec la réalité, qu’il apparaît plus comme celui d’une croyance, d’une secte, qui veut à tout prix imposer son idéologie.
Ainsi, le discours dominant est que nous sommes passés, depuis les années 1980, à une politique économique dominée par ce qui est appelé le néo-libéralisme, sinon l’ultra-libéralisme. En particulier, le keynésianisme, et son concept de relance par la dépense publique a été abandonné. Les politiques actuelles sont des politiques d’austérité, et la crise montre qu’il faudrait revenir à une politique keynésienne, pour relancer la croissance.
Sporadiquement est même dénoncé une loi de 1973, dite loi Rothschild, qui interdirait à la banque centrale de financer les dépenses de l’État. Comme est dénoncée l’austérité de l’Europe, et plus particulièrement de l’Allemagne.
Ces critiques sont paradoxales. En effet, jamais, en temps de paix, les dépenses publiques et les déficits n’ont été si élevés, jamais la politique monétaire n’a été aussi accommodante, et, surtout, jamais les règles qui régissent l’économie mondiale n’ont été aussi keynésiennes. Jamais les États n’ont eu autant de latitude pour dépenser, jamais la dépense n’a été à ce point érigée comme moteur de l’économie. Et, finalement, jamais la politique économique n’a été aussi dirigiste, à part dans les Républiques Socialistes.
C’est à travers la politique monétaire que s’impose ce keynésianisme. Celle-ci a profondément évolué depuis l’après deuxième guerre mondiale, pour devenir un instrument de politique keynésienne.
Après la seconde guerre mondiale, ce sont les accords de Bretton Woods qui régissaient les monnaies. Le principe était celui des parités fixes par rapport au dollar. La valeur de chaque monnaie était déterminée par rapport au dollar. La valeur du dollar étant également fixe, déterminée par une certaine quantité d’or. C’était une sorte d’étalon or inversé.
Concrètement, ce système limitait la création monétaire. Les États-Unis devaient avoir de l’or pour créer de la monnaie. Les autres pays devaient avoir des dollars pour créer de la monnaie. Bien sûr, la relation n’était pas stricte. Il pouvait y avoir création monétaire dans un pays, mesurée, même si les réserves en dollars n’augmentaient pas. Mais le système imposaient des limites, qui empêchaient de trop grands déficits publics.
Imaginons qu’un pays comme la France se lance dans une politique de dépenses publiques. Ce qui entraîne des achats à l’étranger, ne serait-ce que pour les matières premières. Ces achats sont réglés en dollars. Les réserves de changes deviennent insuffisantes, et c’est la crise monétaire.
Cet exemple n’est pas un cas d’école. La France a ainsi connu plusieurs dévaluations dans les années 1950-1960. Aujourd’hui, ces dévaluations sont considérées comme une politique de relance. Or, cela n’a jamais été le cas. Les dévaluations étaient un symptôme : le pays vivait au dessus de ses moyens. Il fallait donc opérer ce qu’on appellerait aujourd’hui un plan d’austérité. Sans compter que les prix augmentaient du fait de l’augmentation des prix des matières premières. Cela se voyait moins qu’aujourd’hui, car la France était en pleine période de rattrapage économique, et que les prélèvements étant inférieurs aux niveaux actuels, il y avait plus de marges pour les augmenter.
Les accords de Bretton Woods tiraient les conséquences de la crise de 1929. Le protectionnisme et les dévaluations compétitives avaient aggravé cette crise. Le monde ne s’était d’ailleurs pas remis de la Première Guerre Mondiale, qui avait été financée par la création monétaire, et avait détruit la stabilité monétaire qui l’avait précédée. Bretton Woods était une tentative de retrouver cette stabilité.
Mais les accords de Bretton Woods ont été rendus caducs par les États-Unis, qui ne les ont pas respectés. Aujourd’hui, nous sommes dans un système de changes mobiles. Ce qui signifie que la création monétaire n’est plus contrainte par la quantité d’or détenue par la banque centrale américaine, ou la quantité de dollars détenue par les banques centrales des autres pays.
Par conséquent, les banques centrales peuvent manipuler les taux d’intérêt comme elles le veulent. Ce qui permet à la banque centrale des États-Unis, la Fed, de baisser les taux d’intérêt pour soutenir la croissance. Ce que fait également la banque centrale européenne, au mépris de son mandat. Cela n’était pas possible avec les accords de Bretton Woods, sauf pour la Fed. C’est parce que la Fed a laissé la création monétaire s’emballer que ces accords sont devenus caducs.
D’autre part, l’activité des banques est contrainte par les critères de Bâle. Ces critères décident de ce qui est risqué et de ce qui ne l’est pas. Ainsi, les crédits aux États ou les placements dans des obligations d’État sont considérés comme sans risque. En deuxième position vient l’immobilier, comme par hasard à l’origine d’une bulle aux États-Unis, et de la crise actuelle. L’investissement dans les entreprises ou le crédit aux entreprises sont au contraire considérés comme risqués. Si une banque accorde un crédit à un secteur considéré comme étant risqué ou achète des titres financiers d’une entreprise classée à risque, elle doit disposer de plus de fonds propre que si elle investissait dans des secteurs considérés comme moins risqués par la réglementation. Ce qui diminue sa rentabilité. Les banques sont donc fortement incitées à mettre de l’argent dans les obligations d’État. Ajoutons que les agences de notations sont également obligées de tenir compte des critères de Bâle, puisque ceux-ci leur donnent leur rôle actuel.
Nous avons donc une réglementation qui favorise la dépense. D’un côté une banque centrale libre de manipuler les taux d’intérêt à sa guise, et donc de les baisser pour relancer l’économie. De l’autre une réglementation qui favorise l’endettement des États. Jamais, en période de paix, les États n’ont pu s’endetter autant sur une longue période.
Notons aussi cet autre paradoxe, à savoir que nous avons connu après la deuxième guerre mondiale une période de croissance alors que la création monétaire était contrainte. Pourtant, on nous serine aujourd’hui que la création monétaire est la clef de la croissance. Encore un exemple de la déconnexion des économistes vis-à-vis de la réalité.
Toutes les règles qui régissent la monnaie sont orientées vers la dépense publique. Tout est fait pour favoriser la dépense publique. Et la politique monétaire est devenue l’alpha et l’oméga de la politique économique. Les banques centrales pensent contrôler l’économie, en accélérant la croissance ou en la ralentissant, via les taux d’intérêt1.
Existe-t-il encore une science économique ? Le débat est trop politisé. Et les politiciens aiment les solutions faciles. Ceux qui proposent ces solutions faciles et des boucs émissaires ont ainsi de beaux jours devant eux.
La CGT, professionnelle du sabordage d'entreprises
Le grand malheur de la SNCM aura été d'avoir pour syndicat majoritaire la CGT, ce boulet national.
Si timorée ou impotente soit-elle, notre classe politique a au moins une excuse : avec un syndicat comme la CGT, toujours à l'avant-garde des combats d'arrière-garde, son métier n'est pas facile à exercer.
M. Sarkozy avait naïvement essayé la manière douce avec l'accord sur la représentativité de 2008, qui assurait à la CGT de garder une grosse part du gâteau syndical, subventions publiques à la clé. On a vu comment sa complaisance fut récompensée.
M. Valls tente, lui, la manière forte en avançant, calme et droit, vers l'objectif de redressement qu'il s'est fixé, sans prêter attention aux récriminations cégétistes. Son assurance est d'autant plus grande qu'il a gagné par KO son épreuve du feu avec la CGT dans le conflit récent à la SNCF. On lui souhaite bien du plaisir pour la suite.
À quoi peut donc servir la CGT ? Même si la centrale, ne souffrant pas la critique, aime rouler les épaules en jouant l'intimidation, c'est pourtant la question qu'il faut oser poser aujourd'hui : avec son parasite SUD - il y en a toujours sur les grosses bêtes -, la Confédération ne travaille-t-elle pas en sous-main pour les industries allemande, chinoise, américaine, indienne ou bulgare ? Un ennemi de l'intérieur ne ferait pas mieux.
La vérité oblige à dire que la CGT est au syndicalisme ce que leFN est à la politique. Un boulet national, une attraction universelle, une "exception française". Non seulement elle enfourche avec obstination toutes les mauvaises causes, mais elle décourage les initiatives, propage des mensonges et attise les haines. Autant dire, doux euphémisme, qu'elle ne contribue pas pour peu au déclin économique de notre pays.
Que la CFDT, à touche-touche avec elle dans le secteur privé, ou que Force ouvrière, dominante dans la fonction publique de l'État, défendent les intérêts de leurs salariés, c'est indéniable. Les deux centrales font leur travail et personne ne conteste leur efficacité. La CGT, elle, abuse ses militants. Elle les envoie même souvent dans le mur, comme on est en train de l'observer à la SNCM, qui, jusqu'à présent, assurait la desserte de la Corse et du Maghreb.
Détruire ce fleuron du transport maritime fut un travail acharné et de longue haleine. Le grand malheur de la SNCM aura été d'avoir pour syndicat majoritaire la CGT, qui n'a jamais cessé de presser l'entreprise comme un citron, au nom d'un prétendu "service public de continuité territoriale de qualité". Sans oublier de saboter régulièrement son image auprès des passagers avec des grèves à répétition.
La particularité de la SNCM, championne mondiale du sureffectif, est que le client n'y est pas le roi, mais, au contraire, le dernier des couillons, pour parler marseillais. Même si elle a été officiellement privatisée, elle se comporte depuis des années comme un monopole de droit divin, nourri au lait des aides ou subventions. Rien d'étonnant si, dans ces conditions, sa grande concurrente privée, Corsica Ferries, lui taille sans arrêt des croupières, réalisant désormais l'essentiel du trafic passagers entre la Corse et la métropole.
La débine de la SNCM est comme une fable : voilà comment un syndicat peut tuer une entreprise. Une histoire édifiante à méditer dans les cours d'économie. Cela changerait nos élèves ou nos étudiants des barbantes litanies professorales contre la mise en pièces de l'État-providence par les hydres sataniques du néolibéralisme, affameurs de l'humanité et suceurs du sang des pauvres.
Si les aventures de la SNCM étaient un film, le scénario aurait été écrit par Michel Audiard,l'auteur génial de la célèbre maxime : "Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." La mise en scène serait celle du Gendarme de Saint-Tropez, tant s'entremêlent, dans cette tragi-comédie, le ridicule, l'inconséquence et, pour rester poli, la bêtise. Le degré ultime du syndicalisme suicidaire.
M. Cuvillier, le secrétaire d'État aux Transports, a fait preuve d'un vrai courage, ce qui lui vaut d'être pris pour cible par la CGT. Chapeau bas. Mais que notre pays ne soit pas révolté par le scandale de la SNCM, coulée par un syndicat tout-puissant, ou que les médias se contentent de donner, non sans paresse, le seul point de vue cégétiste, c'est peut-être le signe, hélas, que nous ne sommes pas encore prêts pour le grand changement mental, économique et social que les événements ne manqueront pas de nous imposer dans les prochains mois. Ne sommes-nous pas tombés assez bas ?
En attendant, puisse la France ne pas faire penser trop longtemps à la SNCM, cette sorte de bateau ivre racketté par son syndicat, ne sachant pas où il va, du genre inutile en mer et dangereux au mouillage.
Big millions !
Big millions !
C'est une affaire de « big millions » ! Ou, si vous préférez, de très gros sous. La publication, hier en soirée, des conclusions de l'audit sur la situation financière de l'UMP, a confirmé l'existence d'une dette de 79,1 millions d'euros. Pour un parti qui n'en finit pas de dénoncer l'impéritie gestionnaire du gouvernement de gauche et de donner des leçons d'économie, cela fait plutôt mauvais effet. Car au-delà de la charge représentée par l'acquisition de l'immeuble de la rue de Vaugirard, le creusement du déficit s'explique par une gestion calamiteuse au fil des années et des pratiques très contestables.
Le triumvirat chargé d'assurer la direction transitoire de l'UMP s'est voulu rassurant sur les capacités de redressement du parti, à la condition de se rallier à une politique d'austérité. Mais si l'UMP paraît en mesure d'échapper à la banqueroute, sa faillite morale est d'ores et déjà consommée. Derrière les chiffres se cachent en vérité des comportements bien éloignés de la vertu civique, traduisant un terrible affaissement démocratique.
Que penser de ces révélations, distillées certes non sans fiel, sur les billets d'avion payés à Madame Copé pour de folkloriques missions de représentation ? Que penser de ces postes de direction grassement rémunérés, à la direction du parti, quand on tend la sébile aux adhérents ? Et tant d'autres choses encore qui témoignent d'une utilisation beaucoup trop « décomplexée » des deniers publics. Mais que penser aussi de ces parlementaires incapables de payer leur cotisation ou de rembourser les frais de campagne ? Ceux qui réclament aujourd'hui avec véhémence la transparence ont été peu regardants sur les comptes.
Voilà pourquoi, l'entreprise de démolition du « système Copé-Sarkozy » vire au processus d'autodestruction dont on voit mal qui pourrait émerger. Tous, revanchards ou calculateurs, oublient leurs propres turpitudes et se battent pour rafler la mise. Ils croient pouvoir devenir des sauveurs en défigurant la politique. En réalité, ils tournoient, avec leurs cris d'orfraie, autour de ce qu'est devenue l'UMP : à savoir un autre cadavre à la renverse.
Les « foot de Dieu »
Les « foot de Dieu »
Depuis avant-hier, le Brésil est plongé dans la déploration. Cette dépression, avouons-le, est aussi disproportionnée que pouvait l'être la ferveur mystique entourant la Seleçao jusqu'à son humiliante élimination par les footballeurs allemands. Les chants montant des gradins, voulaient porter au pinacle Neymar et ses équipiers. Hélas, Dieu n'a pas reconnu les siens. Et il n'a pas été le seul ! Ainsi va le sport, qu'il est sans doute imprudent de trop vouloir mêler à la religion. On sait bien que les croyants sont nombreux en Amérique du Sud et que le football constitue, pour les églises, un vecteur de la culture de masse. Encore convient-il de ne pas tomber dans les excès d'une religiosité en crampons.
Sur les stades, se multiplient en effet de plus en plus les gestes (ou simulacres) religieux. À leur entrée sur le terrain, les joueurs (de toutes confessions) se signent, prient, lèvent les bras et les yeux au ciel. On a même vu les footballeurs brésiliens à genoux (et aussi sur les genoux), implorer à l'issue de leur déroute, on ne sait quel pardon divin.
Entre galipettes orgiaques pour célébrer un but marqué, et signes inappropriés de prosélytisme, on préférerait un juste milieu. À la manière de la charte olympique qui exclut tout signe religieux ostentatoire, il serait bon que les instances du foot y veillent. Ce n'est pas vraiment ce qu'a fait la FIFA (fédération internationale). Sous la pression de la confédération asiatique, dont font partie beaucoup de pays musulmans comme le Qatar, l'Arabie saoudite ou la République islamique d'Iran, le port du voile ou du turban pour les jeunes « footballeuses » a été autorisé. Sous couvert d'expansionnisme du ballon rond.
On sait les stades envahis par trop de dérives (hooliganisme, racisme, chauvinisme) pour ne pas appeler à la vigilance contre toute forme de récupération et d'altération des valeurs universelles du sport. À l'occasion de ce Mondial finissant, l'exemple aura été donné, par le Brésil, d'une forme de déséquilibre émotionnel et irrationnel transformant joueurs et supporters en nouveaux « foot de Dieu ».
Un génocide ignoré
Un génocide ignoré
Au Moyen-Orient, un génocide est en train de se produire dans le silence et l’indifférence générale: celui des chrétiens d’orient, des chaldéens. Ils étaient 2 millions, une dizaine d’années auparavant, et ne sont plus que quelques milliers. La constitution du "Califat" couvrant une partie de l’Irak et de la Syrie a achevé de sceller leur sort. A Mossoul, ne pouvant plus fuir, ceux qui restent subissent un véritable martyr.
Pendant des siècles, les religions chrétiennes et musulmane ont vécu en parfaite harmonie dans cette région du monde. Le chaos, les destructions, les guerres civiles ont ouvert la voie à des idéologues qui utilisent la religion musulmane comme prétexte pour déployer une folie génocidaire comparable aux pires régimes du XXème siècle. Le monde occidental, largement responsable, terrifié, totalement impuissant, abasourdi, couvre cette tragédie du silence de la lâcheté et se drape dans l’indifférence. Pas un mot, pas un murmure: les chrétiens qu’on martyrise, cela ne semble gêner absolument personne dans des sociétés qui paradoxalement, vouent un culte aux droits de l’homme. Ni les médias, ni les classes politiques, ni le monde intellectuel ne bougent un petit doigt… Se taire puisqu’il n’y a rien à faire, et même, chez certains, se réjouir de cette expérimentation en nature du vieux rêve "d’écraser l’infâme". Nous sommes face, me semble-t-il, à l’une des pires trahisons et des pires lâcheté de l’histoire contemporaine.
Inscription à :
Commentaires (Atom)